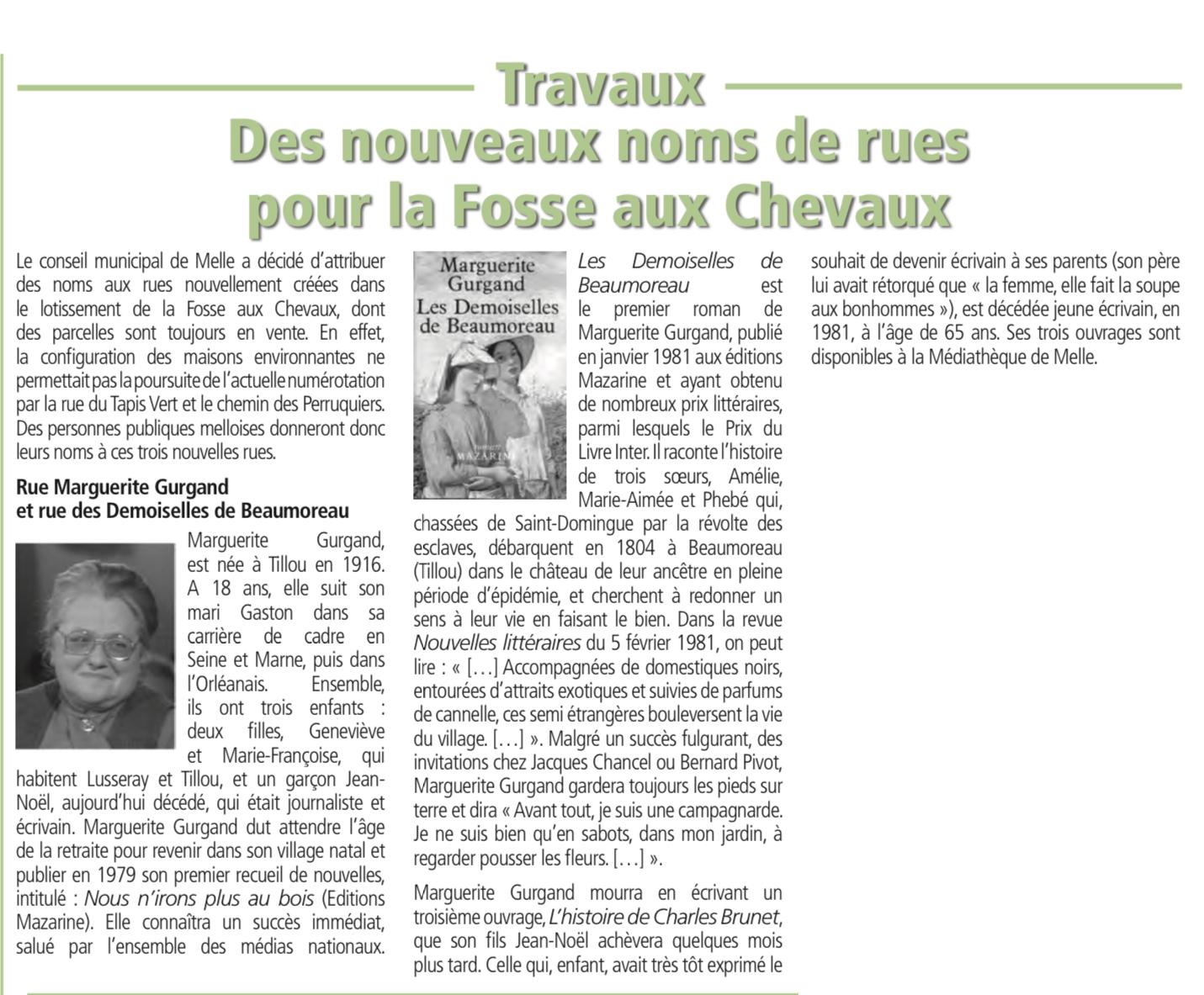Marguerite GURGAND (1916 – 1981)
écrivaine

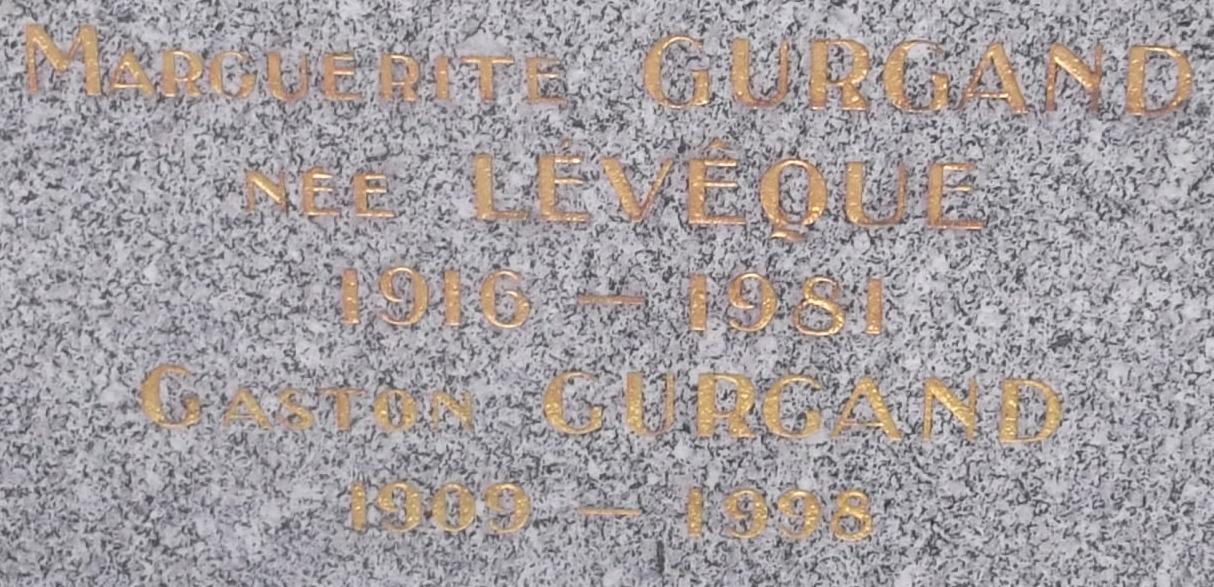
MARGUERITE GURGAND
NEE LEVEQUE
1916 – 1981
GASTON GURGNAND
1900 – 1998
Marguerite Gurgand est
une écrivaine française, lauréate du Prix du
Livre Inter en 1981 pour Les Demoiselles de Beaumoreau.
Les
Demoiselles de Beaumoreau est son premier roman et son deuxième
livre après Nous n'irons plus au bois.
Elle était
en train d'écrire son troisième ouvrage, l'Histoire
de Charles Brunet quand la mort l'a surprise à l'age de 65
ans. C'est son fils, Jean-Noël Gurgand, lui- même
écrivain qui termina ce roman.
Nous n'irons plus au bois.
Les Demoiselles de Beaumoreau
l'Histoire de Charles Brunet
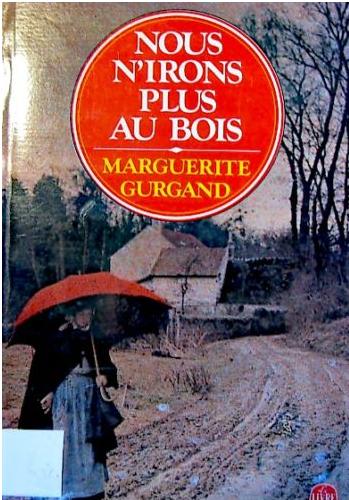
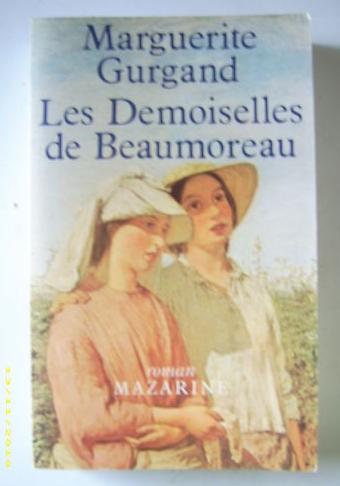
En savoir + cliquez ci-dessus
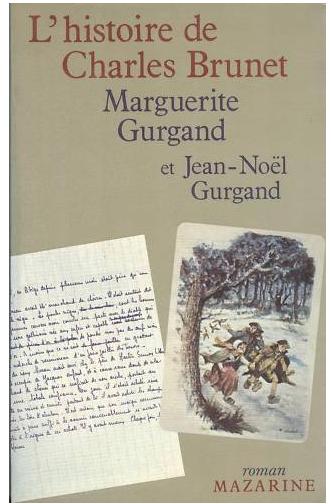
![]() Résumé,
4e
de
couverture :
Résumé,
4e
de
couverture :
La soixantaine venue, les enfants dispersés, Fannie et
Pierre se retirent dans leur province natale, entre Poitou et
Charente. Ce livre débordant d’odeurs, de bruits et
de mots familiers, c’est d’abord l’histoire de
leur retour au village. Pour combler le vide béant de la
« retraite » ils interrogent les photos
sépias des albums de famille et greffent des rosiers :
mais il n’est pas facile de retrouver ses traces dans un
monde qui a plus changé en soixante ans – leurs
soixante ans – que pendant les trois siècles
précédents. C’est pourtant dans ce paysage où
dormait leur enfance que, par-delà l’usure des choses
et des cœurs, ils se trouvent enfin en paix avec
eux-mêmes.
Nous n’irons plus au bois
est la chanson pudique et tendre du temps qui passe, la chronique
douce amère d’aujourd’hui et d’autrefois,
traversée d’éclats de rire et de grands rêves
pour rien.
Assise sur son banc, Marguerite Gurgand
accorde sa voix au frémissement des tilleuls en automne et
raconte la vie. Et cette voix là, en-dehors de toutes les
modes ne s’oublie pas.
Le
début :
Le camion a pris son virage dans la cour en fauchant les orties
géantes. Pierre, avec des signaux à guider des
boeing, l’a fait stopper devant la maison. Les déménageurs
sont descendus en regardant où ils posaient les pieds. Le
grand rouquin qui conduisait s’est étiré, a
passé les pouces dans les bretelles de sa salopette et a
contemplé la rude friche d’alentour :
« Ben dites donc ! Si les légumes viennent
comme les orties !... »
Son
compagnon, un bon gros qui commençait à grisonner,
couvait des yeux la longue maison basse :
« Y
a pas, dit-il rêveusement, ça a du bon, la
retraite… »
L’air était
léger comme une haleine de bébé. Le ciel,
d’un bleu très pâle, paraissait bien plus haut
que celui de Paris. Je me sentais étourdie comme après
une deuxième coupe de champagne. J’ai écarté
les ronces de l’un des bancs de pierre qui encadrent la
porte d’entrée. Je me suis assise, le dos appuyé
au mur bruni
de mousse. Ma sortie de clinique, le voyage, ce silence me
laissaient l’âme vague, au seuil d’un désarroi
inconnu…
Source
: Le Livre de Poche, LGF
![]()
![]() . En cet automne 1804, une épidémie
de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en Bas-Poitou.
. En cet automne 1804, une épidémie
de dysenterie ravage le hameau de Tillou, en Bas-Poitou.
La
maladie n'épargne personne, la mort frappe sans
discernement... L'angoisse pèse sur le village,
l'enveloppant d'un linceul de silence.
C'est alors qu'arrivent
en rude terre poitevine, auréolées de soleil et de
mystère, Marie-Aimée, Amélie et Phoebé
Forgier. Chassées de Saint-Domingue par la révolte
des esclaves, elles viennent s'installer dans leur maison de
Beaumoreau, à l'abri des guerres et des massacres.
Leurs
domestiques noirs terrorisent les villageois qui voient en eux
l'incarnation du diable, mais peu à peu, la beauté,
la bonté et la joie de vivre des Demoiselles ont raison de
toutes les réticences. Colas lui-même, le beau
tisserand, ne peut résister à leur charme.
Source
: J'ai Lu
![]()
Nous n'irons plus au bois de Marguerite Gurgand
Soudain, il m'est revenu que
ce banc sur lequel j'étais assise avait été
une pierre tombale, récupérée dans quelque
haie. Du temps où les protestants étaient interdits
de cimetière par les catholiques, on leur faisait place à
l'ombre des maisons parpaillottes. Chacun gardait les siens. Au
Sud du Poitou, on découvre ainsi parfois au bout d'un
carré de choux un tumulus décoré de
verroteries funéraires, ou encore, au milieu d'un clos
fleuri ou trois cyprès veillant le cimetière
familial. Aujourd'hui encore, certains maintiennent la tradition,
et la coutume locale abolit les décrets qui ont cours
ailleurs.
Nous n'irons plus au bois, p. 9 Mazarine
![]() Dans un village des Deux-Sèvres, au
printemps de 1981, le notaire honoraire Charles Brunet enterre sa
femme, Servane, jadis épousée par intérêt.
C'est pour le vieil homme l'occasion de se retourner sur sa vie,
de retrouver le goût de son enfance pauvre, l'âpreté
des batailles de chaque jour pour échapper aux fatalités
de la misère paysanne. Il revoit comment, poussé par
sa mère Vincente, domestique de ferme et veuve à
vingt ans, il a fini par accéder à l'aisance et à
la respectabilité. La mort de Servane, silencieuse compagne
de sa vie, fait découvrir à Charles Brunet que, tout
à son ambition, il s'était coupé de ceux dont
il voulait le bonheur, sa femme, son fils, ses filles. Dans cette
campagne française bouleversée par les guerres et le
progrès, il n'avait pas compris à temps que sa
réussite, qui représentait toutes les revanches,
contenait déjà tous les échecs. Il ne faut
pas s'y tromper : contée par Marguerite Gurgand, de sa voix
tranquille et amicale, l'histoire de cet homme au bout de son
chemin d'illusions est aussi celle de ce siècle vertigineux
où nous risquons de comprendre trop tard qu'on ne peut
vivre sans tendresse et sans mémoire.
Dans un village des Deux-Sèvres, au
printemps de 1981, le notaire honoraire Charles Brunet enterre sa
femme, Servane, jadis épousée par intérêt.
C'est pour le vieil homme l'occasion de se retourner sur sa vie,
de retrouver le goût de son enfance pauvre, l'âpreté
des batailles de chaque jour pour échapper aux fatalités
de la misère paysanne. Il revoit comment, poussé par
sa mère Vincente, domestique de ferme et veuve à
vingt ans, il a fini par accéder à l'aisance et à
la respectabilité. La mort de Servane, silencieuse compagne
de sa vie, fait découvrir à Charles Brunet que, tout
à son ambition, il s'était coupé de ceux dont
il voulait le bonheur, sa femme, son fils, ses filles. Dans cette
campagne française bouleversée par les guerres et le
progrès, il n'avait pas compris à temps que sa
réussite, qui représentait toutes les revanches,
contenait déjà tous les échecs. Il ne faut
pas s'y tromper : contée par Marguerite Gurgand, de sa voix
tranquille et amicale, l'histoire de cet homme au bout de son
chemin d'illusions est aussi celle de ce siècle vertigineux
où nous risquons de comprendre trop tard qu'on ne peut
vivre sans tendresse et sans mémoire.
Source : Le
Livre de Poche
![]()
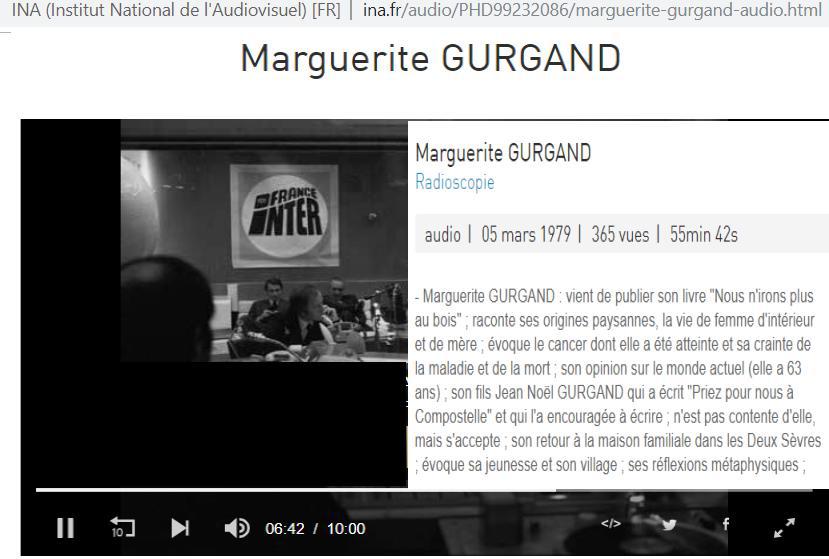

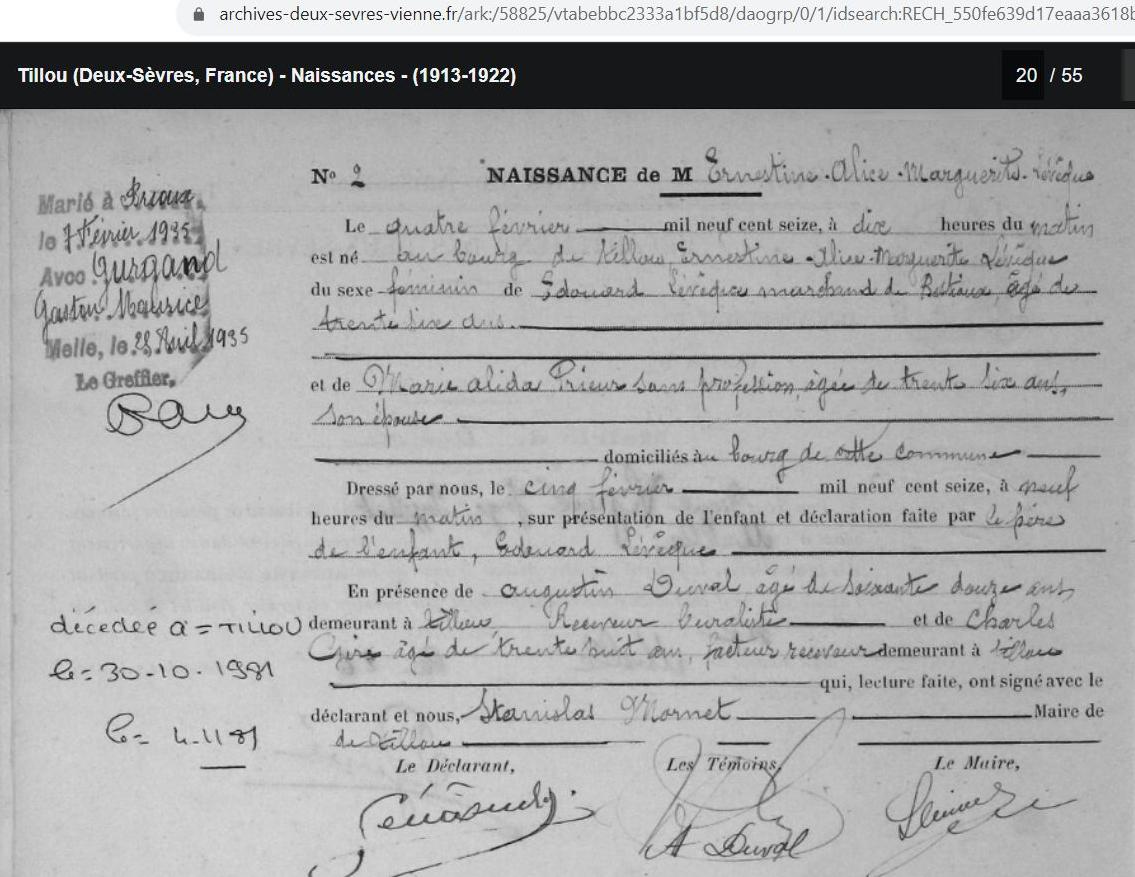
Née le 04/02/1916 à TILLOU
Mariée le 07/02/1935 à BRIOUX
DCD le 30/10/1981 à TILLOU